
La réconfortante carapace de Monsieur Épictète
VIII. Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux. Mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux.
XVII. Souviens-toi que tu es comme un acteur dans le rôle que l’auteur dramatique a voulu te donner : court, s’il est court ; long, s’il est long. S’il veut que tu joues un rôle de mendiant, joue-le encore convenablement. Fais de même pour un rôle de boiteux, de magistrat, de simple particulier. Il dépend de toi, en effet, de bien jouer le personnage qui t’est donné ; mais le choisir appartient à un autre.
XIX. 1. – Tu peux être invincible, si tu ne t’engages dans aucune lutte, où il ne dépend pas de toi d’être vainqueur.
Nous allons développer un peu dans la suite les idées du Manuel d’Epictète. Notez que cette oeuvre n’a pas été rédigée par Epictète lui-même, mais par un de ses élèves (Arrien) qui a fait ici une sélection de ses enseignements (dans la suite de l’article, on fera le raccourci de langage que ce sont les idées/citations d’Epictète). À lire les citations ci-dessus du Manuel, on a l’impression qu’Epictète inculque une sorte de fatalisme et de résignation heureuse face aux événements, qui lui permettent de se protéger de tous les désagréments possibles.
1. Il ne faut pas demander aux choses qu’elles arrivent comme nous le souhaitons, mais se conformer à la fatalité.
2. « Le personnage » qui nous est donné dans le monde (notre fonction, notre statut social, notre richesse etc) est une condition initiale qu’il ne nous appartient pas de changer, il faut la remplir avec zèle (« bien jouer le personnage ») et non chercher à jouer un autre rôle.
3. Est assez intéressant, et je dirais même révélateur de ce qui, je pense, motive Epictète (nous y reviendrons): il faut dans la vie choisir ses combats de sorte à ne jamais pouvoir perdre pour d’autre raison que nous-mêmes, autrement dit se refuser à essayer d’obtenir toute chose qui dépend, même partiellement, d’autrui. Cela permet d’être potentiellement « invincible ». Vous commencez à comprendre le titre de l’article.
Les plus doctes d’entre vous auront remarqué que je ne commence pas cet article consacré au Manuel d’Epictète par sa classique distinction, entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C’est que j’ai voulu commencer par où nous menait Epictète avant de reprendre le déroulé de son raisonnement, que je critiquerai légèrement. En effet, je pense qu’il y a de précieux conseils à retirer de ce Manuel (nous y reviendrons à la fin de l’article), mais je trouve que la philosophie générale qu’il inculque en ce qui concerne la manière d’aborder la vie est un peu trop excessive. Elle verse trop dans le fatalisme, la résignation et l’indifférence (la fameuse ataraxie stoïcienne), comme si elle avait été pensée par quelqu’un qui, avant tout, cherchait à se protéger de la vie.
La distinction, un peu trop manichéenne, entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous
Repartons maintenant du début du Manuel pour expliquer le raisonnement d’Epictète.
I. 1.- Il y a des choses qui dépendent de nous ; il y en a d’autres qui n’en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions : en un mot, toutes les oeuvres qui nous appartiennent. Ce qui ne dépend pas de nous, c’est notre corps, c’est la richesse, la célébrité, le pouvoir ; en un mot, toutes les oeuvres qui ne nous appartiennent pas.
2. – Les choses qui dépendent de nous sont par nature libres, sans empêchement, sans entraves ; celles qui n’en dépendent pas, inconsistantes, serviles, capables d’être empêchées, étrangères.
3. – Souviens-toi donc que si tu crois libre ce qui par nature est servile, et propre à toi ce qui t’est étranger, tu seras entravé, affligé, troublé, et tu t’en prendras aux Dieux et aux hommes. Mais, si tu crois tien cela seul qui est tien, et étranger ce qui t’est en effet étranger, nul ne pourra jamais te contraindre, nul ne t’entravera ; tu ne t’en prendras à personne, tu n’accuseras personne, tu ne feras rien malgré toi ; nul ne te nuira ; tu n’auras pas d’ennemi, car tu ne souffriras rien de nuisible.
Cet incipit du Manuel est fondamental pour comprendre la philosophie d’Epictète. Il se sert d’une distinction logique, ce qui dépend de nous ou ce qui ne dépend pas de nous, pour constituer la base de sa doctrine de vie. Si l’objectif (voir p.ex VIII au début de l’article) est d’être heureux, alors il ne faut pas miser son bonheur sur les choses qui ne dépendent pas de nous puisque ces choses, par définition, sont hors de notre portée et ne nous seront donc pas données. D’où l’idée montrée au début de l’article qu’il vaut mieux se résigner devant les choses qui ne dépendent pas de nous, accepter de jouer le personnage qui nous est donné, afin d’être heureux est même d’être « invinicible ».
Cette approche est logique, et même, pourrait-on dire, plein de sagesse, mais elle repose sur une idée un peu trop simple, qui est que certaines choses ne dépendent absolument pas de nous. Dans la citation précédente, Epictète indique que notre corps, la richesse, le pouvoir ou le statut social, la célébrité ou la réputation, ne dépendent pas de nous. Si on déroule le Manuel (voir les citations au début de cet article), on en déduit qu’il ne sert à rien de rechercher ces choses, et qu’il faut plutôt les accepter comme elles viennent. Dans le cas contraire, on risque d’être malheureux, car notre bonheur dépend de choses extérieures.
Mais il suffit de prendre 4 exemples pour démontrer qu’Epictète a partiellement tort lorsqu’il indique que ces choses (corps, richesse, pouvoir, célébrité ou réputation,) ne dépendent pas de nous:
- Il dépend de moi de bien m’alimenter et de prendre soin de mon corps. Mon corps dépend donc en partie de moi.
- Si j’ai le choix entre deux emplois qu’on me propose, l’un rémunéré le double de l’autre, il dépend de moi de choisir entre ces deux emplois, et donc d’avoir ou non une richesse double.
- Si je travaille par exemple dans une entreprise, il dépend de moi de travailler avec application, de faire du bon travail, de faire en sorte que ce travail soit objectivement appréciable par ma hiérarchie, et enfin de manifester à cette hiérarchie mon aspiration à avoir une promotion.
- Si je suis confronté à un choix en présence d’autres personnes, l’un correspondant à une bonne conduite (p.ex ramasser mes déchets après un pique-nique), l’autre correspondant à une mauvaise conduite (laisser mes déchets sur le sol après le pique-nique), il dépend de moi d’adopter l’une ou l’autre des conduites et donc d’avoir une réputation plus ou moins bonne.
J’aurais pu prendre un tas d’autres exemples. Mais ceux-ci réfutent selon moi l’idée trop simple que notre corps, notre richesse, notre pouvoir et notre réputation ou célébrité ne dépendent pas du tout de nous. Bien sûr, il faut reconnaître à Epictète, que dans ces exemples:
- Malgré tous mes efforts d’hygiène de vie, je peux tomber malade.
- Même si je choisis un emploi mieux rémunéré a priori, on peut par la suite baisser mon salaire, celui-ci ne dépendant pas de moi.
- On peut me refuser toute promotion au détriment d’autres personnes, la décision ne dépendant pas ultimement de moi
- Quelle que soit ma conduite auprès d’autrui, je ne contrôle pas ce qu’autrui pense in fine de moi. Donc, même si je ramasse mes déchets après le pique-nique, quelqu’un peut tout à fait considérer que je ne suis pas fréquentable pour d’autres raisons, ou même considérer que j’ai tort de perdre mon temps à ramasser mes déchets après le pique-nique. Ce qui se passe dans la tête des gens, et la manière dont ils me jugent est en partie hors de ma portée.
En synthèse, Épictète a raison d’indiquer que certaines choses échappent à notre contrôle, mais il a tort de laisser penser que ces choses échappent totalement à notre contrôle. Nous pouvons agir dans une certaine mesure afin d’être bien-portants, d’améliorer nos revenus, de progresser selon nos aspirations professionnelles, et de faire en sorte que les autres ont une bonne opinion de nous.
L’indifférence insensée d’Epictète
J’ai parlé d’indifférence. là aussi, quelque chose me gêne dans la pensée d’Epictète. Ce qui résulte de son mode de vie, c’est l’indifférence aux choses extérieures (et donc en particulier aux choses désagréables). En effet, il indique qu’il ne faut pas être malheureux ou avoir une aversion pour des choses qui ne dépendent pas de nous, car elles relèvent de la nature.
II. 2.- Retire donc ton aversion de tout ce qui ne dépend point de nous, et reporte-là, dans ce qui dépend de nous, sur tout ce qui est contraire à la nature. […]
V. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu’ils portent sur ces choses. Ainsi, la mort n’est rien de redoutable, puisque, même à Socrate, elle n’a point paru telle. Mais le jugement que nous portons sur la mort en la déclarant redoutable, c’est là ce qui est redoutable. Lorsque donc nous sommes traversés, troublés, chagrinés, ne nous en prenons jamais à un autre, mais à nous-mêmes, c’est-à-dire à nos jugements propres. […]
XXXII. […] sache bien que tout ce qui peut arriver est indifférent et ne te concerne pas. Quelque chose que ce soit, il te sera possible d’en tirer bon parti, sans que personne puisse t’en empêcher. […]
On en conclut que tout ce qui peut nous arriver n’est mauvais que dans la mesure où nous avons un jugement mauvais sur ces choses. Pour rester heureux, Epictète recommande donc de transformer les jugements que nous avons sur ces choses et à les considérer avec indifférence, voire avec une légère bienveillance, puisque c’est l’ordre de la nature, et que cela ne dépend pas de nous. Epictète parle ainsi de la mort et dit qu’elle est redoutable parce que notre jugement la décrète redoutable. Plusieurs fois dans son oeuvre il indique qu’il faut voir les choses sous un autre angle, y compris pour ses proches. Ce qu’Epictète oublie selon moi de dire, c’est que peut-être qu’il est plus important d’avoir un jugement mauvais ou négatif sur certaines choses que de chercher à tout prix à rester heureux en essayant de se masquer la réalité derrière une indifférence fataliste. Où irait le monde, si chacun, comme Épictète, refusait de voir le mauvais côté de la réalité, ou ne la considérait qu’avec indifférence voire avec bienveillance? Établir les lois, les faire respecter, bien se conduire avec les autres, tout cela ne suppose-t-il pas de voir et d’expérimenter ce qu’est le bien et ce qu’est le mal ? En plus de la difficulté pratique à transformer nos jugements sur des choses naturelles (je doute que la doctrine d’Epictète puisse consoler efficacement de la perte d’un proche, mais je me trompe peut-être…), il semble donc que cette manière de voir la vie est totalement inopérante en matière de politique et de morale.
Là encore, comme la distinction artificielle entre ce qui ne dépendrait pas de nous, et ce qui dépendrait de nous, l’indifférence d’Epictète me semble être une stratégie d’évitement du réel.
Le cliché social du sage
Ce qui m’a semblé encore plus étonnant, et par là-même un peu moins dangereux car plus absurde, sont les préconisations d’Epictète en matière de sociabilité.
XXXIII. 2.- Soit le plus souvent silencieux. Ne dis que ce qui est nécessaire, et en peu de mots. S’il arrive, rarement toutefois, que s’offre l’occasion de parler, parle, mais que ce ne soit point des premières choses venues. […]
3.- […] Mais, si tu te trouves au milieu d’étrangers, tais-toi.
4.- Ne ris pas beaucoup, ni de beaucoup de choses, ni sans retenue.
6.- Décline les repas extérieurs […]
15.- Évite aussi de chercher à faire rire. C’est une façon de glisser dans la vulgarité, et à la fois un suffisant moyen de relâcher le respect que tes voisins ont pour toi.
A lire Epictète, il faudrait être quasi-muet, ne pas parler aux gens qu’on ne connait pas, ne pas rire, ne pas chercher à faire rire, décliner les invitations à manger. Quelle belle vie sociale que nous recommande là Epictète ! Ces conseils semblent davantage destinés à conforter les personnes qui les appliquent déjà par nature (parce que c’est leur caractère), qu’à convaincre des personnes sociables ou extraverties (on voit mal quelqu’un d’extraverti se comporter du jour au lendemain de la sorte). Je ne vois pas vraiment en quoi ces conseils apportent quelque chose de plus par rapport au reste du Manuel dont on peu suivre les préceptes sans avoir à transformer son personnage social. Ce qui manque à l’oeuvre est d’expliquer en quoi ces conseils seraient utiles.
Pour résumer, Épictète nie ou omet nos efforts possibles pour améliorer notre sort et conclut qu’il faut renoncer totalement à tout ce qui comporte une part d’aléatoire pour être heureux; il considère qu’il faut être indifférent à tout ce qui nous est extérieur, y compris (et surtout) les choses les plus négatives, enfin il recommande une forme d’isolement ou d’austérité sociale. N’est-ce pas là la philosophie d’un être malheureux qui cherche, par le raisonnement, à s’anesthésier de ses souffrances par le fatalisme et l’indifférence? J’ai du mal à imaginer que la condition d’Epictète – on sait qu’il a commencé par être esclave d’un maître cruel, pour ensuite, une fois affranchi, vivre dans la misère avec sa famille – n’ait pas eu d’influence sur cette pensée.
Ne jetons cependant pas le bébé avec l’eau du bain… certes Épictète semble un peu excessif avec sa philosophie de tortue, mais cela ne veut pas dire, loin de là qu’il n’y a rien à en retenir. J’ai souhaité commencer par anticiper toutes les critiques légitimes que l’on pouvait faire à Épictète, je souhaiterais maintenant montrer que son Manuel recèle plein de bons conseils qui, au lieu de servir de carapace, devraient plutôt servir de bouclier.
De la carapace au bouclier: les enseignements utiles d’Épictète
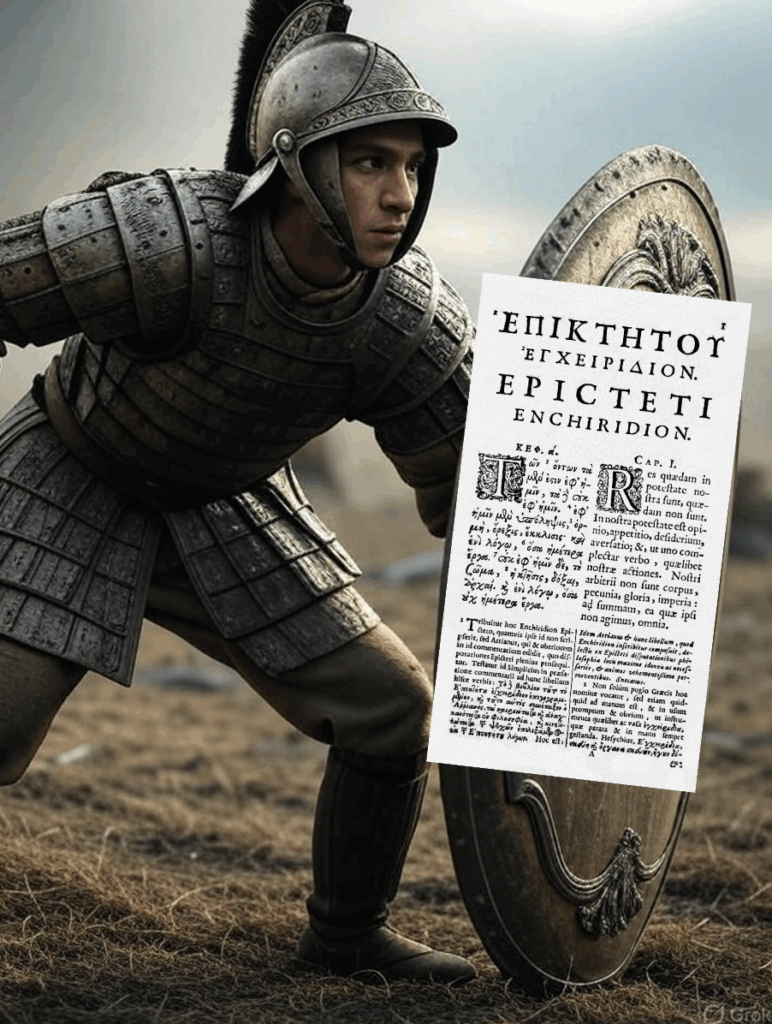
Ne retenons pas la partie fataliste et résignée de la pensée d’Épictète, qui conduit à renoncer à tout ce qui est « hors de nous ». Appliquons plutôt sa pensée de la manière suivante: il dépend de moi de chercher les choses « du dehors » qui me sont favorables (santé, honneur, richesse , mais aussi relations sociales, affectives etc) dans la mesure où cela relève de ma volonté, mais il ne dépend pas de moi de les obtenir automatiquement. Autrement dit, il ne faut pas renoncer à certaines choses sous prétexte qu’elles dépendent en partie des autres, il faut faire le nécessaire pour ce qui concerne la partie qui dépend de nous, mais, si le résultat est de ne pas obtenir ces choses, il faut être stoïque et se dire que nous avons fait tout ce qui est de notre ressort. Le reste de la doctrine d’Epictète s’applique alors très bien: se résigner à ce qui ne dépend pas de nous, les accepter telles qu’elles sont etc. Cette manière de prendre les choses est certes plus difficile, car elle suppose que nous acceptions que nous avons une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, ce que la pensée d’Épictète cherche absolument à effacer.
En résumé, l’enseignement d’Épictète peut être très précieux à condition de ne pas s’en faire un carapace, mais plutôt un bouclier. La différence entre les deux, est que la carapace est une protection systémique contre le réel, qui protège l’organisme du dehors; alors que le bouclier est un élément actif de protection, il s’oriente, se range si nécessaire, et n’a pas vocation à séparer celui qui l’utilise de l’environnement extérieur. Considérés de cette manière, les conseils du Manuel sont remplis de sagesse. Quelle sagesse que de traiter avec indifférence tel événement nuisible qui ne dépend pas de nous ! Pourquoi donc se contrarier avec des choses sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle? Si cette maxime est difficile à appliquer, elle reste néanmoins une boussole que nous devrions toujours avoir avec nous lorsque nous nous sentons démunis par rapport à de mauvaises choses qui nous dépassent.
Au-delà de ce premier enseignement, relatif à la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, voici en complément une série de 7 passages du Manuel que j’ai trouvés intéressants:
IV. Lorsque tu dois entreprendre quelque chose, rappelle-toi ce qu’est la chose dont il s’agit. Si tu vas te baigner, représente-toi ce qui arrive au bain, les gens qui vous éclaboussent, qui vous bousculent, qui vous injurient, qui vous volent. Ainsi, tu seras plus sûr de toi en allant te baigner, si tu te dis aussitôt : « Je veux me baigner, mais je veux encore maintenir ma volonté dans un état conforme à la nature ». […]
Ce passage porte sur la résolution et nous invite, dans les choses que nous souhaitons réaliser, à commencer par concevoir toutes les difficultés pratiques que la réalisation de cette chose suppose. Epictète prend l’exemple d’un bain public, en indiquant que si on a envie de se baigner, autant se représenter tout de suite qu’il y aura d’autres personnes, que cela pourra être désagréable, etc. On pourrait prendre un autre exemple: vous voulez commencez à apprendre quelque chose, comme une nouvelle langue, ou un instrument de musique. Représentez-vous que cela va être long et difficile au début, et ensuite décidez si oui ou non vous voulez le faire, cela vous permettra d’anticiper les difficultés et d’éviter d’abandonner.
IX. La maladie est une entrave pour le corps, mais non pour la volonté, si elle ne le veut. La claudication est une entrave pour les jambes, mais non pour la volonté. Dis-toi de même à chaque accident, et tu trouveras que c’est une entrave pour quelque autre chose, mais non pour toi.
Epictète invite ici à écarter les mauvaises excuses, du style: je suis malade donc, je ne peux faire cela, et invite à toujours prioriser la volonté. Ce conseil est précieux car il est vrai que les individus ont tendance à se trouver des excuses pour ne pas agir. La volonté n’admet aucune entrave, à part elle-même lorsqu’elle refuse de s’exercer.
X. A chaque accident qui te survient, souviens-toi, en te repliant sur toi-même, de te demander quelle force tu possèdes pour en tirer usage. Si tu vois un bel homme ou une belle femme, tu trouveras une force contre leur séduction, la tempérance. S’il se présente une fatigue, tu trouveras l’endurance; contre une injure, tu trouveras la patience. Et, si tu prends cette habitude, les idées ne t’emporteront pas.
J’apprécie beaucoup ce paragraphe X. Il invite à nommer les forces qui nous permettent de surpasser nos faiblesses. Au lieu de nous laisser aller à la fatigue, à la colère, à la langueur amoureuse, Epictète nous invite à invoquer les antidotes correspondants. Vous êtes fatigué, réalisez aussitôt que vous avez besoin de l’endurance. Le fait d’identifier cette force intérieure permet de l’activer. Très utile.
XXVIII. Si quelqu’un livrait ton corps au premier venu, tu en serais indigné. Et toi, quand tu livres ton âme au premier rencontré pour qu’il la trouble et la bouleverse, s’il t’injurie, tu n’as pas honte pour cela?
Très puissant. Nous rappelle de conserver en nous-même notre centre de gravité, en particulier pour des gens que nous connaissons à peine. N’est-il pas en effet ridicule de se livrer totalement à des gens que nous venons de rencontrer? Soit en leur parlant de nous, soit en pensant à eux de manière incessante? Ces gens ne méritent ni de savoir qui nous sommes, ni notre attention prolongée.
XXXIV. Quand une idée de plaisir se présente à ton esprit, garde-toi, comme pour les autres idées, de ne te point laisser par elle emporter. Mais diffère d’agir et obtiens de toi quelque délai. Compare ensuite les deux moments : celui où tu jouiras de plaisir, et celui où, ayant joui, tu te repentiras et tu te blâmeras. Oppose à ces pensées la joie que tu éprouveras à t’abstenir et les félicitations que tu t’adresseras. Et, si les circonstances exigent que tu agisses, prends garde à ne pas te laisser vaincre par ce que a chose offre de doux, d’agréable et d’attrayant. Mais récompense-toi en pensant combien il est préférable d’avoir conscience que tu as remporté cette victoire.
Encore un conseil très précieux. Avant de céder à nos pulsions, visualisons les conséquences négatives d’un tel acte. Le regret, la honte, pour une maigre sensation de plaisir, à comparer au bonheur et au soulagement d’avoir résisté. Développer systématiquement cette visualisation négative avant de faire quelque chose que l’on risque de regretter, nous permet de mieux nous maîtriser.
XLIII. Toute chose a deux anses ; l’une par où on peut la porter, l’autre par où on ne le peut pas. Si ton frère a des torts; ne le prends pas du côté par où il a des torts; ce serait l’anse par où on ne peut rien porter. Prends-le plutôt par l’autre, te rappelant qu’il est ton frère, qu’il a été nourri avec toi, et tu prendras la chose par où on peut la porter.
Autrement dit, voir les choses du bon côté. Cela a un intérêt pratique souvent sous-estimé.
XLVI. Ne te dis jamais philosophe, et garde-toi le plus souvent de parler de maximes à des gens vulgaires. Fais plutôt ce que prescrivent les maximes. Par exemple, ne dis pas dans un festin comment il faut manger, mais mange comme il faut. […]
Conseil très sage que ce paragraphe XLVI. Au lieu de frimer à dire aux autres qu’on leur est supérieur parce que l’on fait telle ou telle chose, il est préférable d’agir conformément à ses principes en silence.
Epictète et la démocratie
Enfin, j’aimerais terminer cet article par une réflexion sur la citation suivante, déjà mentionnée au début de l’article.
XVII. Souviens-toi que tu es comme un acteur dans le rôle que l’auteur dramatique a voulu te donner : court, s’il est court ; long, s’il est long. S’il veut que tu joues un rôle de mendiant, joue-le encore convenablement. Fais de même pour un rôle de boiteux, de magistrat, de simple particulier. Il dépend de toi, en effet, de bien jouer le personnage qui t’est donné ; mais le choisir appartient à un autre.
J’ai dans cet article critiqué ce passage du Manuel car il repose sur un fatalisme social consistant à penser que chacun de nous reçoit une fonction/un statut immuable dans la vie qu’il ne nous appartient pas de choisir mais plutôt de bien remplir. Il faut dire que les temps ont considérablement changé depuis Épictète. Comme l’indique Tocqueville, et j’en parle dans mes articles consacrés à De la démocratie en Amérique, le propre de la démocratie c’est que les individus ne sont jamais fixés dans un milieu mais cherchent en permanence à en sortir pour acquérir de nouveaux biens. Il y a une effervescence sociale centrée sur la recherche du bien-être matériel, qui passe nécessairement par l’accroissement de richesses. Un citoyen démocratique ne vous comprendrait pas si vous lui disiez, comme Épictète, que ses richesses ne lui appartiennent pas, et qu’il faut qu’il joue un rôle prédéfini. La question que je pose est la suivante: ne peut-on pas imaginer, à la lumière de la philosophie d’Épictète, qu’aujourd’hui les gens sont moins heureux qu’auparavant car ils sont sans cesse insatisfaits, et cherchent toujours des choses « du dehors » (pour reprendre la formulation d’Épictète): plus d’argent, plus de pouvoir, plus de confort? La démocratie abolissant les grands corps sociaux (encore que), il n’y a plus un personnage qu’on nous donne à la naissance, mais nous essayons sans cesse de redéfinir notre personnage. Cette instabilité permanente de l’existence sociale, où chacun se compare, n’est-elle pas finalement source de frustration plus que de satisfaction? Je laisse la question ouverte.
